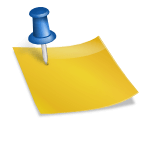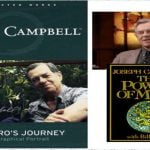La durée d’une scène est problématique : trop longue, elle ennuie ; trop courte, elle ne dit rien sur l’intrigue. Il nous faut trouver un équilibre. Ce sera le rythme intérieur du récit. Pour le scénariste, nous évoquerons directement ce que Bergson appelait la durée vécue, opposée au temps mesurable des horloges : ce n’est pas la quantité de minutes qui compte, mais la qualité de l’écoulement, la densité du devenir.
Une scène peut être brève et sembler longue si la tension dramatique y est figée, devenue pesante, ou au contraire paraître fulgurante si les enjeux y sont en perpétuelle métamorphose. Écrire une scène, c’est donc organiser des mouvements de la conscience, c’est-à-dire des attentes, des hésitations, des élans ou des résistances qui créent une continuité sensible. Le scénariste, tout comme Bergson face à la durée intérieure de la conscience, cherche moins à mesurer qu’à éprouver : il façonne un temps vivant, élastique, irrégulier, plastique si on le veut, mais profondément organique.
Je le répète assez souvent, c’est important : nous écrivons une scène, nous devons la justifier. Qu’elle soit descriptive (sans empiéter sur le travail du metteur en scène ou de l’acteur), qu’elle participe à la progression du récit, qu’elle nous en dit plus sur un personnage, qu’elle prépare une situation conflictuelle ou encore qu’elle soit cryptique, la durée de la scène est à la mesure de ce qu’il s’y passe.
Parce que c’est ainsi que le lecteur/spectateur la percevra. Si vous l’étirez au-delà de ses limites naturelles, alors toute la scène s’effondrera, même si elle est nécessaire au récit entier. Dit autrement, si nous jugeons mal de la longueur d’une scène, c’est tout notre récit qui prend péril.
Une scène trop longue provoque l’ennui chez le lecteur/spectateur, car elle provoque de l’indifférence. Donc comme on s’ennuie, on commence à s’occuper l’esprit en anticipant. Mais c’est une mauvaise anticipation. La véritable anticipation qui est implicite dans l’écriture est une promesse, une attente et la tâche du scénariste consiste à les déjouer dans un retournement, une révélation…
C’est une sorte de pacte silencieux : le lecteur/spectateur devine ce qu’il pourrait arriver… et le scénariste le laisse croire qu’il a raison. Jusqu’au moment où il tord légèrement la trajectoire. L’anticipation devient alors un levier dramatique. Elle est non seulement tolérée, mais irremplaçable, à condition qu’elle ne soit jamais totalement comblée ou, pire, confirmée sans surprise. L’art, ici, c’est de doser l’écart entre ce que le lecteur/spectateur attend et ce que le récit lui donne : trop faible, l’effet tombe à plat ; trop grand, il perd confiance. Entre les deux, naît l’attention soutenue et le plaisir.
Une scène comme matière
Mettre en mots la lumière et les ombres, voilà le travail du scénariste. Je ne dis pas pour toutes les scènes, mais la relation de votre lecteur/spectateur avec certaines scènes doit être tactile, une véritable expérience sensorielle. On ne commande pas, on propose. Métaphores, textures, rythmes se joignent dans la scène en une unité. La lumière et les ombres deviennent dramatiques et langage : elles signifient, elles affectent autant les personnages que le lecteur/spectateur qui les perçoit. Le Conformiste (1970) de Bertolucci utilise la lumière et les ombres pour refléter les états intérieurs des personnages et créer une atmosphère de tension et de malaise.
Des jeux d’ombres symbolisent les secrets et les mensonges des personnages. Le scénario intègre ces éléments visuels, ainsi, la lumière et des ombres amplifient l’effet émotionnel du récit sur le lecteur/spectateur. Vous ferez de même avec les couleurs.
Pour devenir matière, l’espace d’une scène singulière ne se compose pas seulement d’une lumière, de couleurs et d’ombres, mais aussi des lieux que les personnages habitent ou qu’ils ne font que traverser. Ne tuez pas vos scènes dans un lieu figé. Le choix de l’arrière-plan dépend de la relation qui se joue dans une scène entre les personnages, ou même entre un personnage et lui-même. Soyez fidèle à votre écriture, ne la trahissez pas en ne pensant pas vos lieux comme des arrière-plans qui participent de la relation qui s’éploie dans une scène. Dans Wendy and Lucy (2008) de Kelly Reichardt , chaque lieu n’est jamais simplement un décor hasardeux : il est le miroir discret de l’état intérieur du personnage de Wendy.
Elle traverse des non-lieux (des parkings, des supermarchés, des terrains vagues), mais ces lieux deviennent chargés, parce qu’ils répercutent la précarité de sa situation, son isolement, sa persévérance aussi. L’espace incarne une silencieuse tension dramatique : elle dort dans sa voiture, elle erre dans les rues anonymes d’une petite ville de l’Oregon, et pourtant, chaque lieu semble prolonger la relation entre elle et son chien, Lucy.
Il est difficile de donner de la matière aux idées, abstraites par leur nature même. Concevoir un objet comme symbole d’une idée est une recherche passionnante et redoutable, mais possible. Les gants blancs de Roy Hobbs (Le Meilleur (1984) de Barry Levinson) portent l’idée du contraste entre pureté, innocence et les ombres d’une vie et d’une carrière.
Et bien que cela reste vague, mais si vous sentez que lors d’une scène, votre lecteur/spectateur risque de décrocher, permettez-lui de s’agripper à quelque chose de sensible ; alors l’objet symbolique devient remarquable.
La tâche du scénariste consiste essentiellement à traduire dans l’espace et dans le geste (par geste, j’entends autant le mouvement que les attentes (les espérances par exemple, ou les aspirations)) une intériorité, habituellement inaccessible à nos sens. Alors, donnons de la chair. Le monde est empli d’une multitude incommensurable de chairs ; chacune d’elles est une expression d’elle-même comme autant de regards qui renvoient diverses images de nous-mêmes comme autant d’impressions sensorielles, car nous ne sommes pas seulement des miroirs tournés vers le monde extérieur et qui nous rendraient insensibles.
De tous ces regards, le scénariste se saisit et les place dans l’espace de la scène : un regard un peu appuyé ; une hésitation ; un personnage se dissimule dans les ombres ou s’expose au centre de la scène dans la lumière ; ou encore un trajet dans l’espace de la scène pour dire l’état psychique à ce moment du récit. C’est ainsi que Saint Omer (2022) d’Alice Diop possède cette sublime capacité à transmettre l’intériorité de ses personnages à travers des gestes et des espaces.
Et puis, il y a le corps en relation intime avec l’espace. En tant que scénariste, nous incarnons un corps comme personnage (et non pas comme actrice ou acteur, à chacun son art). Dans l’espace scénique (en tant qu’une scène d’un scénario), les émotions, les pensées, l’état psychologique dans lequel se trouve un personnage se matérialisent dans le mouvement et le comportement. Portrait d’une jeune fille en feu (2019) de Céline Sciamma a cette habileté à transcrire des intériorités à partir des gestes, des mouvements et d’une interaction avec l’espace scénique. Ainsi des regards échangés entre Marianne et Héloïse, des hésitations dans leurs gestes, et les moments où elles se trouvent seules ou ensemble dans des espaces singuliers, nous disent leurs émotions et leur état psychologique.