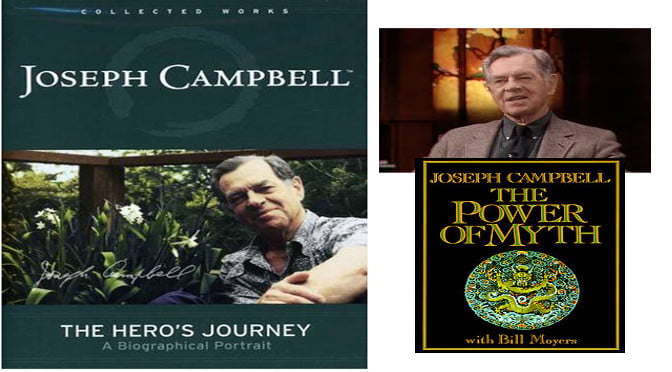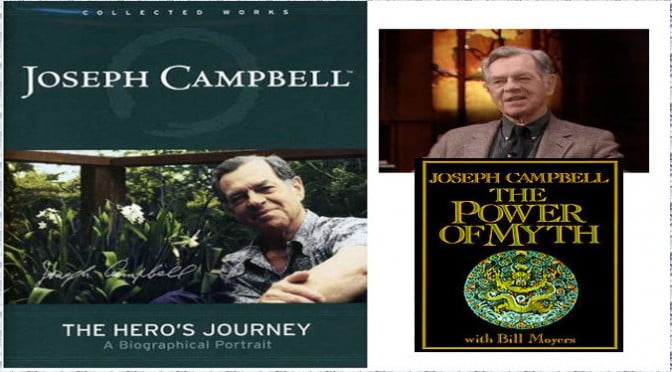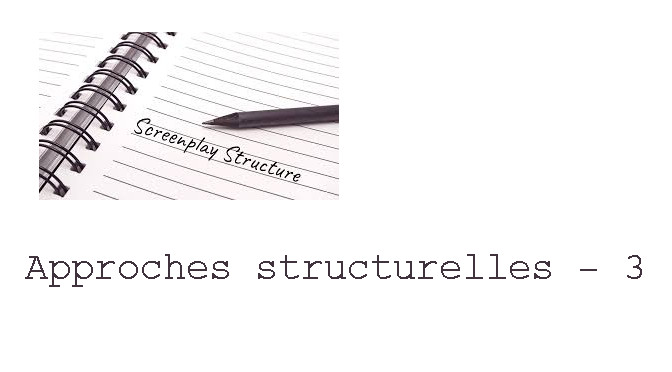Notre expérience immédiate et sensorielle est déterminante dans notre compréhension du monde et des autres. Parmi ces autres se trouvent nos êtres de fiction. Il est vrai que notre première rencontre avec autrui, c’est surtout du côté de nos sens qu’elle s’élabore : ce que nous voyons de l’autre, ce qu’il dit ou peut-être même ce qu’il nous cache, et pour lequel nous avons seulement un sentiment confus qu’il y a toujours plus à connaître au-delà de la surface ; nos autres sens ne sont pas en reste non plus.
Ce que nous percevons d’emblée, c’est un corps, une attitude, tout un ensemble de signes qui nous apprennent, du moins que nous croyons découvrir, qui est cet autre, et ce, avant même que nous ayons l’occasion de pénétrer sa subjectivité.
Quand nous rencontrons la toute première fois un personnage, nous ignorons encore qui il est. Donc, la première impression, c’est-à-dire son apparence, est un signifiant immédiat. Celui-ci est visible, mais derrière l’apparence, il y a autre chose. Tout le travail de l’autrice et de l’auteur consistera au fil de l’intrigue, bien plus que lors de l’exposition du premier acte, à nous faire la démonstration de qui est vraiment ce personnage.
C’est ainsi qu’il nous apparaîtra dans sa vérité et si, de fortune, il est appelé à devenir autre qu’il n’est tel que nous l’avons connu, ce qu’on nomme l’arc dramatique de sa transformation, alors ce sera en quête de sa propre vérité que nous accompagnerons , nous aussi, ce personnage au long du récit.
 Nous pouvons admettre que notre esprit cherche à synthétiser les choses afin de les mieux comprendre. Toute l’astuce pour l’autrice et l’auteur est de combler les vides de leur personnage avec quelques détails suffisamment significatifs pour que le lecteur/spectateur esquisse une image mentale, et souvent inconsciemment, du personnage. Considérons un instant The Guilty (2018) de Gustav Möller pour expliciter comment notre esprit cherche à comprendre une situation : ici, tout se passe de manière que notre imagination soit sollicitée dès que Asger communique avec la personne à l’autre bout du fil.
Nous pouvons admettre que notre esprit cherche à synthétiser les choses afin de les mieux comprendre. Toute l’astuce pour l’autrice et l’auteur est de combler les vides de leur personnage avec quelques détails suffisamment significatifs pour que le lecteur/spectateur esquisse une image mentale, et souvent inconsciemment, du personnage. Considérons un instant The Guilty (2018) de Gustav Möller pour expliciter comment notre esprit cherche à comprendre une situation : ici, tout se passe de manière que notre imagination soit sollicitée dès que Asger communique avec la personne à l’autre bout du fil.
Nous prenons le moindre indice que nous croyons percevoir et tentons de reconstituer ce qu’il se déroule. C’est précisément un même jeu d’apparences, car qui ou quoi nous affirme que nos perceptions sont justes ?
Le masque
Certes, la plupart d’entre nous offrons à l’autre une image qui ne correspond que peu ou prou à ce que nous sommes à l’intérieur. On est deux finalement : une projection et une subjectivité. Il nous arrive de craindre la seconde, car une réserve, une honte peut-être, nous garde de l’extérioriser. Il arrive aussi que nous nous conformions aux attentes des autres et, en leur présence, nous arborons le masque qu’il leur plaît.
Pourtant, cette apparence n’est pas légère. Au contraire, elle est une réalité et ce que nous percevons dans l’instant d’un individu nous parle déjà de lui sans que nous cherchions à approfondir de manière trop souvent hypothétique la psyché de cette personne. Ce que nous offrons aux regards des autres, c’est une partie de nous-mêmes et ce que nous leur en donnons fait certainement retour sur la propre conscience que nous avons de nous-mêmes.
 À quoi sert le masque sur le plan narratif ? Deux options se proposent : soit le personnage s’enferme dans cette première impression que nous avons de lui ; ou alors toute l’intrigue consistera en son effort pour déconstruire cette perception initiale. I Care a Lot (2020) de J. Blakeson nous présente Marla Grayson, qui, derrière une image de femme d’affaires impeccable, procède à des activités très amorales. Elle a un contrôle total sur son apparence et ses postures, mais ce masque dissimule ses véritables intentions. Cette maîtrise de soi est bien davantage qu’une illusion : elle est sa vérité sociale et Marla se définit par cette projection qu’elle impose aux autres.
À quoi sert le masque sur le plan narratif ? Deux options se proposent : soit le personnage s’enferme dans cette première impression que nous avons de lui ; ou alors toute l’intrigue consistera en son effort pour déconstruire cette perception initiale. I Care a Lot (2020) de J. Blakeson nous présente Marla Grayson, qui, derrière une image de femme d’affaires impeccable, procède à des activités très amorales. Elle a un contrôle total sur son apparence et ses postures, mais ce masque dissimule ses véritables intentions. Cette maîtrise de soi est bien davantage qu’une illusion : elle est sa vérité sociale et Marla se définit par cette projection qu’elle impose aux autres.
Cette réalité est non seulement perçue par les autres personnages, mais ils l’adoptent aussi : pour le juge, elle est une professionnelle éthique et compétente ; Marla se complaît dans cette image qu’elle renvoie d’elle-même et s’assume totalement comme une prédatrice. Pour la société, ce masque est sa seule réalité.
Une seconde tension se met alors en place : Roman voit au-delà du masque de Marla et ce fait menace le contrôle absolu qu’elle possède sur elle-même. Soudain vulnérable, le récit néanmoins ne cherche pas sa rédemption : Marla refuse d’abandonner son masque et ainsi, l’apparence devient son identité.
Une étrange association
Apparence et essence (la véritable nature d’un être, enfin, de son incarnation dans le monde) peuvent connaître une approche particulière dans une fiction. L’apparence sera considérée harmonieuse. Pour reprendre ce que j’ai dit plus haut, notre esprit éprouve du plaisir dans la synthèse qu’il fait de la diversité des choses que nos sens reçoivent ; c’est un plaisir esthétique qui n’a pas de finalité en soi : nous éprouvons du plaisir, c’est tout.
Quand l’apparence d’une personne nous est agréable, nous ressentons de la joie ; et certes, si l’instant d’après, nous faisons une autre rencontre avec un individu qui nous est foncièrement antipathique, ce sentiment de joie se dissout dans la répulsion. Mais là n’est point mon propos. Alors que l’apparence nous apparaît sublime (j’emploie le mot de Kant), en tant qu’auteur et autrice, ainsi l’essence de ce même personnage sera monstrueuse.
 J’ai une question : est-ce que cette nature monstrueuse fait du personnage une incarnation du mal ? N’est-ce pas plutôt la société elle-même qui fait d’un individu un monstre parce qu’il dérange, comme il est discordant avec les normes et les critères esthétiques que nous nous imposons ? The Apprentice (2024) de Ali Abbasi peut nous aider en effet à comprendre. C’est le récit d’une relation : Donald Trump et son mentor Roy Cohn. Le contexte est fondamental (les années 1970 et 80) car il s’agit de la période de formation et nous pouvons penser d’initiation du jeune Trump à l’idée de prédateur intrinsèquement liée au rêve américain (tout comme chez Marla).
J’ai une question : est-ce que cette nature monstrueuse fait du personnage une incarnation du mal ? N’est-ce pas plutôt la société elle-même qui fait d’un individu un monstre parce qu’il dérange, comme il est discordant avec les normes et les critères esthétiques que nous nous imposons ? The Apprentice (2024) de Ali Abbasi peut nous aider en effet à comprendre. C’est le récit d’une relation : Donald Trump et son mentor Roy Cohn. Le contexte est fondamental (les années 1970 et 80) car il s’agit de la période de formation et nous pouvons penser d’initiation du jeune Trump à l’idée de prédateur intrinsèquement liée au rêve américain (tout comme chez Marla).
Nous avons donc une apparence séduisante d’un personnage qui est déterminé à réussir. Seulement, ce paraître dissimule une autre réalité : des pratiques immorales, une éthique dévorée par une inextinguible soif de pouvoir. Et que suggère ce récit ? Que rien autre que la société valorise ce type de comportement : des valeurs dévoyées, certes, mais au profit de la réussite.
Et maintenant, les préjugés
Donner à la première impression une telle importance, c’est fort probablement solliciter chez le lecteur/spectateur les éventuels préjugés qu’il pourrait posséder à l’égard de la réduction de l’autre à son apparence. Dans ce cas, il vaut mieux jouer avec les archétypes plutôt que de se laisser aller aux stéréotypes plus faciles, mais tellement fades.
L’archétype n’en demeure pas moins une apparence ou une image dont il faut pouvoir dépasser le concept. Un héros, un mentor, un traître… sont un ensemble de traits de caractère rassemblés en un tout cohérent. Comment, alors, le déclassifier pour qu’il soit à la fois reconnaissable dans sa fonction et véritablement autre sous notre regard (également en tant qu’auteur et autrice ou lecteur/spectateur) ?
Chaque personnage, quelle que soit sa fonction, est un sujet qui a des doutes, des contradictions et des fragilités. Saisissez les occasions où le personnage s’évade de sa fonction : un méchant de l’histoire qui prend soin d’un chat montre chez lui peut-être une compassion ou, du moins, une vulnérabilité et cela l’humanise. Commodore dans Gladiator de Ridley Scott est un être infâme, mais lorsqu’on comprend que sa perspective sur le monde est biaisée par le manque d’un amour partagé avec son père, on peut se permettre sans scrupules de le comprendre.
Chacun de nous possède une part de mystère, des zones d’ombre qu’il serait vain pour quiconque de tenter de saisir dans une totalité. Ce serait même un manque de respect que de vouloir nous définir en niant nos singularités. Dites-vous bien qu’aucune transparence n’est possible : l’autre nous est décidément hors d’atteinte. Et c’est mieux ainsi.