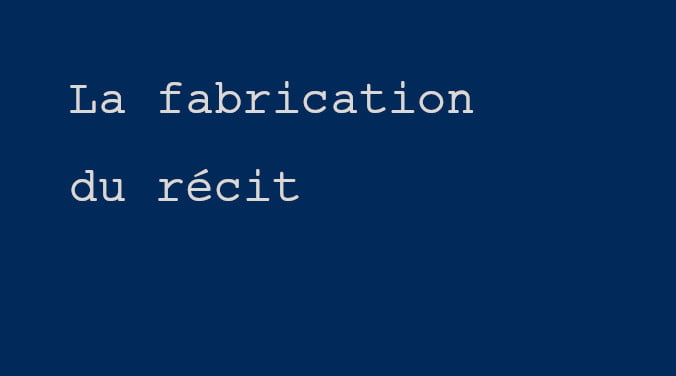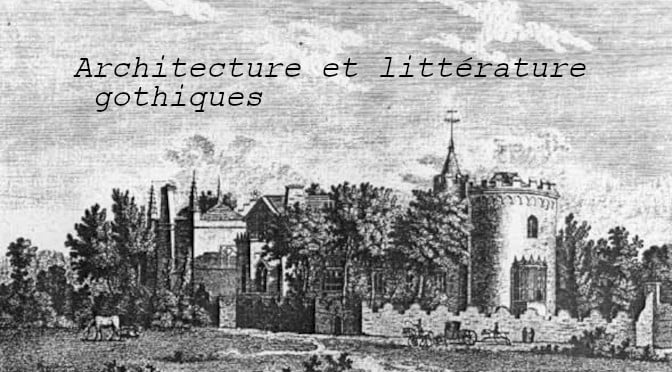Lors du précédent article, nous parlions de l’emploi du surnaturel dans le gothique avec Samuel Taylor Coleridge. Voici ce qu’il dit à propos des Lyrical Ballads, un recueil de poèmes que Coleridge a coécrit avec William Wordsworth.
Les incidents et les références devaient être, au moins en partie, surnaturels ; et l’excellence recherchée devait consister dans la qualité des affections éprouvées par la vérité dramatique de telles émotions, qui accompagneraient naturellement de telles situations, les supposant réelles.
Et en ce sens, elles l’ont été pour tout être humain qui, de quelque source d’illusion que ce soit, s’est, ne serait-ce qu’un moment, cru sous un pouvoir surnaturel.
Coleridge s’est donc tourné vers des personnages surnaturels (souvent puisés dans nos propres croyances) afin de donner, tiré de nous, des qualités humaines et un semblant de vérité suffisant pour procurer à ces ombres de l’imagination cette suspension volontaire de l’incrédulité, ne serait-ce que pour un moment, qui constitue la foi poétique.
Des explications naturelles inutiles
Parmi les écrivains gothiques les plus importants, seule Ann Radcliffe se donne la peine de produire des explications naturelles pour tous les effets apparemment surnaturels, et de nombreux lecteurs trouvent ses explications plus distrayantes que les événements apparents qui les occasionnent.
Le trait distinctif du roman gothique à ses débuts est son atmosphère et comment elle est mise en jeu. L’implication de l’imagination du lecteur est au cœur de l’entreprise gothique, même dans une tentative aussi rudimentaire que celle de Walpole.
Avec le recul, l’atmosphère gothique semble aujourd’hui mécanique, conçue avec de grosses ficelles narratives afin d’obtenir cet effet singulier spécifique du gothique, même dans les plus grands de ces romans, constate Robert D. Hume, mais à l’origine son but était de susciter et de sensibiliser l’imagination du lecteur, lui donnant plus de pouvoir qu’il n’en apprécie habituellement, et l’utilisation du surnaturel était clairement destinée à contribuer à ce stimulus imaginatif.
Parmi les productions entre 1764 et 1820 une distinction semble nécessaire entre le roman de terreur et le roman d’horreur. Cette distinction trouve son origine dans l’esthétique du milieu du dix-huitième siècle.
Comme le dit Ann Radcliffe, la terreur et l’horreur sont tellement opposées que la première accroît l’âme et les facultés à un plus puissant sentiment de vie ; alors que l’horreur contracte, fige et les annihile presque (ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose).
Ni Shakespeare, ni Milton par leurs fictions, ni Edmund Burke par son raisonnement, précise Ann Radcliffe, n’ont vu l’horreur comme une source du sublime, alors qu’ils s’accordent à dire que la terreur est une affection très positive. Bref, la terreur ouvre l’esprit à l’appréhension du sublime, tandis que (selon Ann Radcliffe) la répugnance impliquée dans l’horreur le referme.
La terreur associée au suspense est le modus operandi des romans de Walpole et Radcliffe. Le Château d’Otrante retient l’attention du lecteur par la menace d’une série de terribles possibilités — l’exécution de Théodore, le mariage (essentiellement) incestueux de Manfred et Isabella, le naufrage d’Hippolita, et ainsi de suite.
L’utilisation par Ann Radcliffe du suspense dramatique est semblable, mais plus sophistiquée. Elle soulève de vagues possibilités mais troublantes et les laisse pendant des centaines de pages.
 Dans son texte sentimental fondateur, Julie, ou La Nouvelle Héloïse (en 1761), Jean-Jacques Rousseau utilise le voile pour aider à définir l’image d’une féminité idéale qui influencera des générations de textes sentimentaux et gothiques. En mourant, le lieu de la passion indisciplinée de Julie, c’est-à-dire son corps, est recouvert d’un voile, où émerge une image stable de pureté féminine.
Dans son texte sentimental fondateur, Julie, ou La Nouvelle Héloïse (en 1761), Jean-Jacques Rousseau utilise le voile pour aider à définir l’image d’une féminité idéale qui influencera des générations de textes sentimentaux et gothiques. En mourant, le lieu de la passion indisciplinée de Julie, c’est-à-dire son corps, est recouvert d’un voile, où émerge une image stable de pureté féminine.
Plus grand best-seller du dix-huitième siècle, le roman de Rousseau eut un tel succès qu’il connut un culte et fut responsable de populariser le spectacle de la mort, notamment la mort d’une belle femme. Ces thèmes ont influencé Les Mystères d’Udolphe où une image voilée et deux fantômes féminins constituent les mystères centraux du titre.
Les fantômes de Signora Laurentini et de la Marquise de Villeroi forment des aspects extrêmes de l’identité féminine sentimentale qu’Emily, l’héroïne, doit apprendre à gérer, et le voile au cœur de l’histoire représente ce lieu du débat que se livre à elle-même Émilie.
Parfois l’effet peut paraître peut-être artificiel, mais en soulevant et en soutenant la possibilité inquiétante d’une affaire entre St-Aubert et la Marquise de Villeroi, par exemple, Radcliffe réussit magnifiquement à instiller du suspense et même une certaine terreur.
La manipulation facile du suspense par Ann Radcliffe retient l’attention du lecteur malgré des intrigues bien légères. Les méthodes de Matthew Gregory Lewis, de William Beckford, de Mary Shelley et de Maturin sont considérablement différentes de celles de Radcliffe. Au lieu de retenir l’attention du lecteur par le suspense ou la peur, ils l’attaquent frontalement avec des événements qui le choquent ou le perturbent.
Plutôt que d’élaborer des possibilités qui ne se matérialisent jamais, ils entassent une succession d’horreurs sur le lecteur. Lewis cherche délibérément à dépasser Radcliffe. Le Moine (en 1796), comme Vathek de Beckford (en 1786), Frankenstein de Shelley et Melmoth : L’homme errant de Charles Robert Maturin, tirent beaucoup d’effets du meurtre, de la torture et du viol.
La différence avec la terreur gothique est considérable ; Ann Radcliffe suggère simplement ces choses, et Walpole utilise des morts violentes seulement au début et à la fin de son œuvre. Le lecteur n’est préparé à aucune de ces morts, qui ne servent qu’à attirer d’abord son attention et à produire ensuite un climax.
Emmener le lecteur vers d’autres horizons
De toute évidence, un changement considérable s’est produit, remarque Robert D. Hume. Le but du gothique est-il simplement un choc toujours plus grand ? Ou la théorie esthétique des écrivains gothiques a-t-elle changé ?
La terreur gothique fonctionne sur la supposition qu’un lecteur qui éprouve de la répulsion fermera son esprit (sinon le livre) aux sentiments sublimes qui peuvent être suscités par le mélange de plaisir et de douleur induit par la peur.
L’horreur gothique suppose que si les événements ont une consistance psychologique, même dans des situations répulsives, le lecteur se trouvera impliqué par son vécu, par ses expériences et ne pourra atteindre des horizons sublimes, incapables de se dépasser lui-même.
Ce changement est probablement lié à un tournant majeur dans les conceptions du bien et du mal. Considérés à la Renaissance comme philosophiquement et pratiquement distincts, ces notions se rapprochèrent de plus en plus dans les deux siècles suivants. Ce mouvement culmina dans la collusion du bien et du mal propre à certains romantiques et incarnées par exemple dans Le mariage du Ciel et de l’Enfer, cette prose poétique inspirée des versets de la Bible de William Blake en 1793 et le drame de Lord Byron Caïn écrit en 1821.
Et qui aurait pu soupçonner que Satan fut le héros du Paradis Perdu de John Milton ? Walpole et Ann Radcliffe maintiennent les propriétés d’une stricte distinction entre le bien et le mal, bien que le Prince d’Otrante et l’usurpateur Signor Montoni soient des méchants gothiques par excellence dont la force de caractère leur donne un certain attrait effrayant, même dans un contexte moral de dilution du bien et du mal l’un dans l’autre.
Mais avec les méchants de l’horreur gothique, nous entrons dans le domaine d’une morale ambiguë. Ambrosio, Victor Frankenstein et Melmoth sont des hommes d’une capacité extraordinaire dont les circonstances les obligent de plus en plus à de mauvais desseins. Ils ne sont pas seulement des monstres, et seule une lecture bigote les rend comme tels.
Le suspense des circonstances extérieures dans l’horreur, c’est-à-dire par exemple une rencontre avec un monstre, un spectre ou bien encore observer une scène de violence, est déplacé en faveur d’une préoccupation psychologique croissante aboutissant à une ambiguïté morale.
Les écrivains gothiques d’horreur postulaient la pertinence d’une telle psychologie chez chaque lecteur ; ils ont écrit pour un lecteur qui pourrait dire avec Goethe qu’il n’avait jamais entendu parler d’un crime qu’il ne pouvait pas imaginer commettre.
Le roman de terreur a préparé la voie à une fiction qui, bien que plus ouvertement horrible, est à la fois plus sérieuse et plus profonde. C’est avec Frankenstein et Melmoth : L’Homme Errant que le roman gothique prit tout son sens.
Parce que Frankenstein (paru en 1817) continue d’être lu comme une histoire d’horreur, une discussion critique sérieuse est rare, constate Robert D. Hume. Mais c’est à la fois un livre habilement construit et d’une véritable perspicacité psychologique. La présence d’un explorateur (Robert Walton) comme narrateur n’est pas seulement un moyen de transmettre l’histoire, mais sert aussi de parallèle et de renforcement pour les thèmes principaux du livre.
L’idée qui imprègne le livre est celle d’un Prométhée aux objectifs trop ambitieux. Victor Frankenstein tente de devenir un dieu, et cette volonté le détruit. La vie et la mort m’apparurent comme des limites de notre imagination, que je devais d’abord franchir, puis répandre un torrent de lumière dans notre monde obscur. Une nouvelle espèce me bénirait en tant que créateur et origine… [on pourrait se référer à la pensée de Maître Eckhart au moins sur la création en tant que vie, en tant qu’existence et qui est véritablement Dieu hors de toute genèse].
 Aucun père ne pourrait réclamer la gratitude de son enfant aussi complètement que je devrais la mériter. Victor Frankenstein est une figure semblable à Adrian Leverkühn de Thomas Mann (Le Docteur Faustus) ; il détruit son humanité en tentant de développer son art musical au-delà du possible, par des moyens n’appartenant pas à l’homme.
Aucun père ne pourrait réclamer la gratitude de son enfant aussi complètement que je devrais la mériter. Victor Frankenstein est une figure semblable à Adrian Leverkühn de Thomas Mann (Le Docteur Faustus) ; il détruit son humanité en tentant de développer son art musical au-delà du possible, par des moyens n’appartenant pas à l’homme.
A l’image de soi
L’être que Victor Frankenstein crée (et dont il croyait en la beauté) reflète dans sa forme extérieure sa propre déformation intérieure. L’idée du monstre, qui aspire à l’amour, est un reflet ironique de la personnalité de Victor Frankenstein, car il ne peut ni aimer ni répondre correctement aux sentiments humains.
La confusion actuelle dans la terminologie des Comics entre Frankenstein et son monstre n’est pas surprenante, car Victor Frankenstein est un monstre, et dans un sens réel, il est le monstre.
Encore et encore, Victor se nomme lui-même meurtrier de sa famille et de ses amis ; au début, il se blâme d’avoir lâché dans la nature un être si dangereux, mais comme le roman avance, nous sommes bien obligés de constater que Victor Frankenstein comprend, à moitié sous l’emprise de la folie, que le monstre est une projection (une forme objective) des implications de la propre inhumanité de Victor.
C’est ce qui rend l’histoire vraiment troublante. Une boucherie insensée par un monstre inhumain serait effrayante, mais pas plus ; ici elle n’est pas insensée, mais tout à fait raisonnée. Victor Frankenstein est d’abord explicitement décrit comme un homme avec des élans bienveillants et d’une grande potentialité pour le bien.
Sa recherche d’une grandeur plus qu’humaine (peut-être telle que Nietszche en avait eu l’intuition) détruit la chaleur de son humanité, et peu à peu il devient totalement impliqué avec le monstre qui objective toutes ses propres insuffisances. La fuite vers le nord reflète littéralement leur abandon de la société et l’absorption mutuelle de leur moi.
Melmoth : L’Homme Errant est le dernier et clairement le plus grand des romans gothiques de cette période, dit Robert D. Hume. Melmoth lui-même est l’incarnation du méchant romantique, un hybride du Juif Errant (Le Juif Errant, figure de la légende européenne, méprisa Jésus sur sa progression vers la croix au Calvaire, et comme punition pour cela fut condamné à errer sans fin jusqu’à la Parousie) et du Satan de Milton (dont l’œuvre la plus importante Le Paradis Perdu est aussi sans cesse interpellée par Mary Shelley et forme l’un des principaux contextes de son Frankenstein) avec une pointe du Hollandais Volant pour compléter la peinture de Melmoth (peut-être parce que la malédiction du capitaine est une sorte de contrat avec le mal), ajoute Robert D. Hume.

La structure du livre est simple du côté des thèmes mais élaborée sous l’angle narratif ; l’œuvre se compose d’une série de contes imbriqués les uns dans les autres, chacun dit d’un point de vue différent. Le thème principal est le sadisme, moral et physique, religieux et social. Melmoth erre, destructeur et se damnant lui-même, cherchant vainement un salut que son caractère entêté ne fait que repousser.
Le lecteur est lui aussi repoussé par son sadisme, mais ne peut s’empêcher de ressentir la stature tragique donnée à Melmoth par l’immensité de sa souffrance. Cette ambiguïté dans la réponse du lecteur, Melmoth la partage avec des personnages tels que Frankenstein et son monstre, Macbeth, le capitaine Ahab et Leverkühn.
Le lecteur voit clairement que Melmoth, comme le Docteur Faust de Christopher Marlowe (La Tragique Histoire du Docteur Faust écrite en 1592), n’est pas condamné par ce qu’il fait, mais par sa propre quête désespérée et peut-être orgueilleuse de pardon et de salut. Ce sera cependant dans l’amour d’Immalie que Melmoth se verra offert la rédemption.
Je vous donne rendez-vous dans un prochain article pour la suite. Si vous croyez en la tentative de Scenar Mag de vous apporter le plus d’informations et de connaissances possibles pour vous aider dans tous vos projets d’écriture, alors, s’il vous plaît, faites un don en retour afin de nous aider à persévérer à vos côtés pour vous soutenir. La connaissance se donne. Aidez-nous à partager. Merci